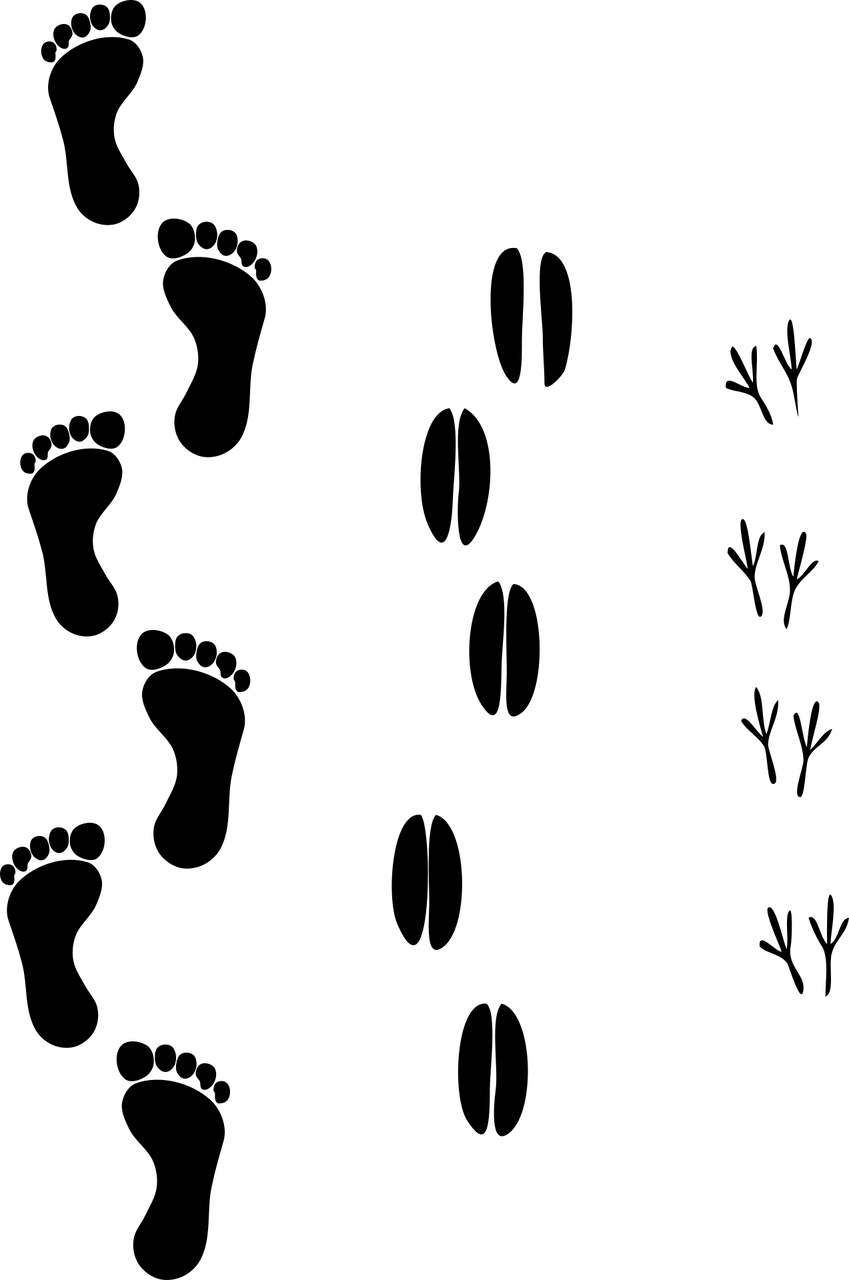|
EN BREF
|
Exploration écologique : Une étude pionnière sur l’empreinte carbone de la création artistique a été réalisée sous l’égide du ministère de la Culture, en collaboration avec le cabinet PwC. Cette initiative vise à évaluer les émissions de gaz à effet de serre (GES) générées par le secteur subventionné de la création artistique, avec un accent particulier sur le spectacle vivant et les arts visuels. L’évaluation met en lumière une empreinte globale estimée à 8,5 millions de tonnes de CO²e par an. Un aspect essentiel de cette étude est la mise en place de réunions collectives avec diverses associations professionnelles, ce qui a permis de définir des plans d’action pour réduire l’empreinte carbone. Des initiatives solidaires et écoresponsables, comme la standardisation des châssis de décors pour limiter le transport, montrent l’engagement du secteur dans cette démarche de transformation écologique. Les résultats préliminaires de l’étude ont été dévoilés lors du Festival d’Avignon, avec d’autres détails à attendre pour 2025, afin de contribuer à la stratégie nationale bas carbone en visant une neutralité carbone d’ici 2050.
Dans un monde de plus en plus conscient des enjeux environnementaux, l’empreinte carbone du secteur de la création artistique devient une préoccupation majeure. Une étude récente, résultant d’une collaboration entre le ministère de la Culture et le cabinet PwC, a permis d’évaluer l’impact carbone de diverses activités créatives. Cette recherche s’inscrit dans un cadre qui vise à réduire l’empreinte carbone des structures artistiques, tout en les formant aux enjeux de la transition écologique. En analysant les émissions de gaz à effet de serre (GES) et en identifiant des solutions durables, cette étude apparaît comme un modèle pour d’autres secteurs. Cet article explore les détails et les implications de cette étude sur l’empreinte carbone de la création artistique.
Contexte et motivation de l’étude
Face aux défis environnementaux croissants, le ministère de la Culture a pris l’initiative de mener une étude sur l’empreinte carbone dans le domaine artistique. L’objectif est d’aligner les pratiques artistiques avec les objectifs climatiques nationaux et internationaux. Cette recherche a été engagée dans le cadre du guide d’orientation et d’inspiration du ministère, témoignant ainsi de l’importance grandissante de l’écologie dans le secteur culturel.
La mise en œuvre de cette étude a été confiée à PwC, avec le soutien du Département des études, de la prospective, des statistiques et de la documentation (DEPS-DOC). Ce partenariat vise à récolter et analyser des données cruciales pour mieux comprendre les émissions de GES produites par le secteur. Cette initiative, qui s’appuie sur des référentiels carbone, a pour ambition de guider efficacement les structures artistiques dans l’évaluation et la réduction de leur empreinte.
Une démarche collective et inclusive
L’importance de l’étude réside également dans sa dimension collective. En effet, elle a mobilisé les associations professionnelles de 11 labels et 5 réseaux de création, englobant les équipes artistiques et les festivals. Cet engagement collectif a permis de renforcer la sensibilisation aux enjeux liés à la transition énergétique et à la nécessité de réduire l’impact carbone.
Un des axes de cette démarche a été la formation des équipes artistiques sur les actions visant à diminuer leur empreinte. Parmi celles-ci, on retrouve des approches telles que l’écoconception, la mobilité durable, et l’optimisation de l’utilisation de l’énergie. De plus, cette étude a donné lieu à la réalisation de plus de 100 bilans carbone de diverses structures, ce qui a permis de dégager un panorama exhaustif des émissions du secteur.
Les grands résultats de l’étude
Les résultats de l’étude sur l’empreinte carbone du secteur de la création artistique offrent deux éléments clés. Tout d’abord, les émissions de GES du secteur subventionné ont été évaluées avec précision à 400 kilotonnes de CO²e par an. Cela représente environ 5% de l’ensemble des émissions des activités artistiques, qui incluent le spectacle vivant, les arts visuels et l’enseignement supérieur de la création artistique.
En parallèle, une extrapolation des données a permis d’estimer que l’empreinte carbone totale du secteur culturel pourrait atteindre 8,5 millions de tonnes de CO²e par an, soit 1,3% de l’empreinte totale de la France. À titre comparatif, ces émissions se situe à un niveau supérieur à celles générées par le transport aérien intérieur, qui représente 0,7%, alors que le secteur numérique contribue à hauteur de 4,4%.
Focus sur les émissions des secteurs spécifiques
Pour avoir une vision plus précise de l’empreinte carbone, l’étude a également analysé les contributions spécifiques des secteurs au sein de la création artistique. Dans le secteur du spectacle vivant, la mobilité des spectateurs s’est révélée être le premier poste d’émission, représentant 38% des émissions totales. Cette donnée soulève des questions quant aux moyens de transport utilisés et à l’accessibilité des événements culturels pour le public.
En ce qui concerne les arts visuels, la même tendance a été observée. La mobilité des visiteurs représente 65% des émissions, tandis que les achats de biens et services, incluant les décors et costumes, contribuent à 19%. Ces statistiques soulignent l’importance de prendre en considération les comportements des visiteurs et des professionnels du secteur pour mettre en place des stratégies de réduction efficaces.
Initiatives innovantes pour réduire l’empreinte carbone
En réponse à ces constats, plusieurs initiatives ont vu le jour, visant spécifiquement à diminuer l’impact carbone du secteur. Par exemple, le collectif 17h25, réunissant des institutions prestigieuses comme le Théâtre du Châtelet et l’Opéra de Paris, travaille à la standardisation des châssis de décors. Cette approche permet de réduire les transports concernant les tournées, source majeure d’émissions.
De même, au festival d’Avignon, des efforts sont déployés pour acheminer les décors en utilisant le ferroutage, contribuant ainsi à réduire le nombre de véhicules sur les routes. Ces exemples illustrent comment des collaborations au sein du secteur peuvent mener à des changements concrets et bénéfiques pour l’environnement.
Vers un avenir durable pour la création artistique
Suite à la présentation des résultats au Festival d’Avignon, il a été annoncé qu’une synthèse des données concernant le spectacle vivant sera publiée, tandis que des détails sur les arts visuels et l’enseignement supérieur apparaîtront à la rentrée 2025. Cela témoigne d’un engagement à long terme de la part du ministère et des acteurs du secteur à continuer cette réflexion sur l’empreinte carbone.
Les résultats de cette étude seront également intégrés dans la 3e Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC), essentielle pour calibrer les politiques publiques visant à réduire les émissions de GES au niveau national. Avec l’ambition d’inscrire le secteur de la création artistique dans une trajectoire vers la neutralité carbone d’ici 2050, cette initiative ouvre des perspectives enthousiasmantes tant pour le milieu culturel que pour l’environnement.
Conclusion ouverte sur des perspectives d’action
En somme, cette étude pionnière sur l’empreinte carbone des activités créatives jette les bases d’un important changement dans le secteur culturel. Les résultats et les initiatives qui en découlent offrent un aperçu de ce qui peut être réalisé grâce à une concertation entre acteurs, soutien aux bonnes pratiques et sensibilisation des différents intervenants. Pour aller plus loin, le secteur doit continuer à innover et à s’adapter pour faire face aux impératifs écologiques, tout en garantissant l’accès et le soutien à la création artistique.

Témoignages sur l’Exploration Écologique
Dans le cadre de l’étude pionnière sur l’empreinte carbone de la création artistique, plusieurs acteurs du secteur témoignent de l’importance d’une telle démarche. Avec une volonté commune d’optimiser l’impact environnemental, cet audit scientifique est perçu comme un outil crucial pour évaluer et réduire les émissions de GES.
Jean, directeur d’un festival culturel, explique : « Participer à cette étude nous a permis de prendre conscience de l’ampleur de notre empreinte carbone. En moyenne, notre événement génère une quantité significative de CO², surtout à travers la mobilité des visiteurs. Grâce à ces données, nous pouvons maintenant envisager des solutions concrètes pour diminuer notre impact. »
Clara, une scénographe engagée, partage son expérience : « Je fais partie du collectif Scénogrrrraphies, et cette étude a renforcé notre réflexion sur l’avenir de la scénographie. La création d’une écothèque pour partager nos recherches et ressources est une initiative précieuse qui découle de ce travail collectif. »
Marc, responsable des achats d’une grande institution artistique, souligne : « Les résultats de l’étude montrent que les achats de biens et services représentent 25% de notre empreinte. Cela nous pousse à revoir nos pratiques d’approvisionnement et à privilégier les matériaux durables et recyclables. »
La collaboration entre les labels et réseaux artistiques a également été mise en avant par Sophie, directrice d’une association professionnelle : « Cette démarche collective nous a permis de croiser les expériences et d’élaborer un plan d’action solide. En unissant nos forces, nous pouvons avancer plus rapidement vers une transformation écologique significative. »
Enfin, Luc, un artiste visuel, déclare : « Cette évaluation de l’empreinte carbone est une vraie prise de conscience pour nous tous. La mobilité des visiteurs, représentant 65% des émissions dans notre secteur, nous incite à repenser nos stratégies de présentation et de diffusion. »