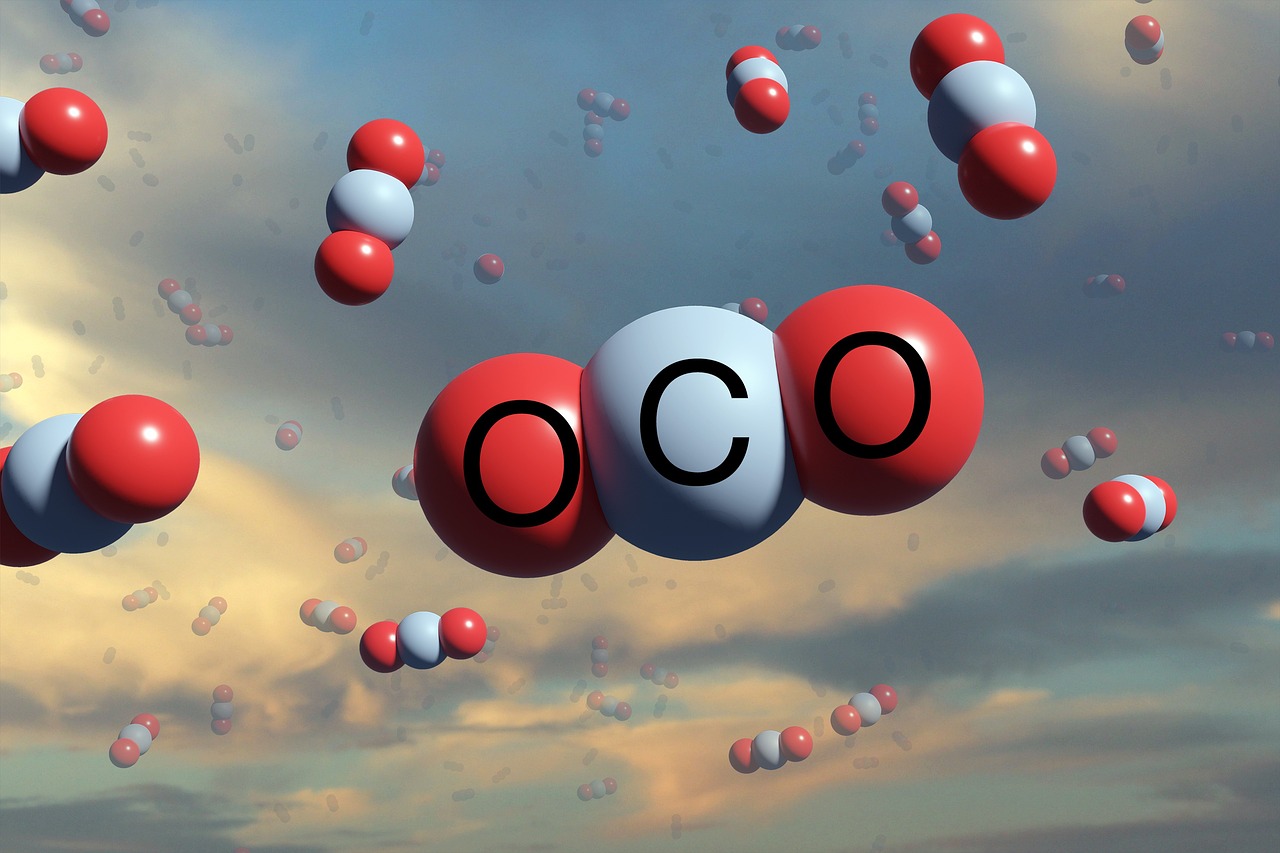|
EN BREF
|
Le CNRS se positionne comme un acteur incontournable dans la transformation écologique et l’engagement sociétal. Sous l’impulsion de son président, Antoine Petit, l’organisme insiste sur l’indissociabilité entre les défis environnementaux et sociaux. En mettant en place un schéma directeur développement durable et responsabilité sociétale (DD&RS), le CNRS trace une feuille de route ambitieuse pour la période 2025-2027, intégrant des engagements en faveur de la transition environnementale et de la politique sociale. Ce schéma, fruit d’une collaboration à tous les niveaux, recense plus de 100 actions interconnectées visant à réduire l’empreinte carbone, à promouvoir la diversité, et à anticiper les besoins de compétences nouvelles pour accompagner ses agents dans ces transformations. Ainsi, le CNRS se fixe pour objectif de repenser ses pratiques de recherche à l’échelle collective, alliant excellence scientifique et responsabilité sociétale.
Le CNRS : Pilier de la Transformation Écologique et de l’Engagement Sociétal
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) se positionne comme un acteur essentiel dans la transformation écologique et l’engagement sociétal. Sous la direction d’Antoine Petit, le CNRS œuvre inlassablement pour lier les dimensions environnementales et humaines, tout en développant des politiques responsables qui visent à transformer les pratiques de recherche et à améliorer la qualité de vie des agents. Par le biais de son schéma directeur en matière de développement durable et de responsabilité sociétale, l’organisme s’engage à intégrer des préoccupations environnementales et sociales dans toutes ses activités. Cet article approfondit les actions et les engagements du CNRS en faveur de la durabilité et de la responsabilité sociétale.
Une vision intégrée : La relation entre environnement et travail
Antoine Petit, président-directeur général du CNRS, insiste sur le fait que la dimension environnementale et la dimension humaine des transitions socio-écologiques sont profondément interconnectées. Cette vision systémique est cruciale pour traiter les problématiques environnementales de manière efficace. Le CNRS s’efforce de rendre ses activités non seulement plus durables, mais aussi plus bénéfiques pour la qualité de vie et le bien-être au travail de ses agents. Cela inclut un dialogue social actif, où les préoccupations des employés sont prises en compte pour améliorer les conditions de travail.
Dans ce cadre, le CNRS a mis en place un schéma directeur dédié à la responsabilité sociétale (DD&RS), qui sert de feuille de route pour les actions à entreprendre pour faire face aux défis écologiques et sociaux. Loin d’être une simple formalité, cette démarche s’inscrit dans un processus d’élaboration collégiale, impliquant tous les niveaux de l’organisme, du local au national, et transversal à toutes les disciplines.
Un cadre stratégique pour la durabilité
La publication du schéma DD&RS en début 2025 marque une étape majeure dans l’engagement du CNRS en faveur de la transition environnementale. Ce document n’est pas seulement une orientation pour les années à venir, mais un véritable outil de concertation qui permettra de structurer les actions existantes et d’en introduire de nouvelles.
De plus, tous les organismes relevant du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en France sont également conviés à créer des schémas directeurs similaires. Cela crée une dynamique de convergence entre les différentes tutelles et renforce les actions engagées dans ce domaine.
Un contexte historique : Actions globales et engagements collectifs
L’intégration des préoccupations sociales et environnementales au CNRS s’inscrit dans une tendance globale qui remonte au Sommet de Rio en 1992. Ce sommet a catalysé des efforts d’éradication de la pauvreté et de promotion de la responsabilité sociétale, soulignant l’importance d’impliquer à la fois les acteurs publics et privés. Le schéma DD&RS comme exemple français récent, se positionne dans cette continuité.
Pour le CNRS, cet engagement est réaffirmé par des démarches multilatérales, telles que la déclaration signée en janvier 2024, qui engage l’ensemble des organismes de recherche nationaux à contribuer aux transitions socio-écologiques, dans le respect de l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050. Parallèlement, cet engagement national est accompagné par une initiative européenne significative, la signature de l’accord de Heidelberg en octobre 2024, qui vise à encourager une recherche durable à l’échelle de l’UE.
Une politique des ressources humaines engagée
Antoine Petit souligne aussi l’intérêt du CNRS pour les ressources humaines en tant que pilier de cet engagement sociétal. Le CNRS s’est inscrit dans la Stratégie européenne des ressources humaines pour les chercheurs (HRS4R) depuis 2017, démontrant ainsi son dévouement à une politique des ressources humaines respectueuse des attentes de ses agents.
Le renouvellement du label HRS4R octroyé par la Commission européenne est une reconnaissance de l’effort continu du CNRS pour améliorer les conditions et la mobilité des chercheurs. De plus, les actions engagées pour promouvoir la diversité, y compris l’emploi des personnes en situation de handicap, et la lutte pour l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, montrent que le CNRS ne limite pas son engagement aux préoccupations environnementales, mais les étend également aux aspects sociaux.
Les engagements en matière de transitions environnementales
Le schéma DD&RS s’étendant de 2025 à 2027, représente une réelle opportunité pour le CNRS d’approfondir son action en faveur de la transition environnementale. En 2020, l’organisme a pris conscience de l’importance d’intégrer les impacts environnementaux dans ses recherches et actions. Un plan de transition bas carbone a été élaboré, et les résultats d’un bilan d’émissions de gaz à effet de serre effectué en 2022 ont conduit à des actions concrètes.
Le CNRS a également sollicité l’avis de son Comité d’éthique, qui a affirmé que prendre en compte la dimension environnementale de la recherche était une responsabilité collective. Ceci a conduit à une dynamique d’engagement pour accompagner les chercheurs dans la compréhension et l’intégration de ces dimensions dans leurs travaux.
Des actions concrètes : Mobilité, numérique et déchets maîtrisés
Le schéma DD&RS prévoit plus de 100 actions interconnectées, s’articulant autour de quatre axes principaux : stratégie et gouvernance, recherche et innovation, environnement, et politique sociale. Une attention particulière est portée sur les mobilités décarbonées, le numérique responsable, et la gestion des déchets. Parmi les initiatives notables, on trouve des efforts pour réduire l’empreinte environnementale des achats, considérés comme représentant 85% des émissions de gaz à effet de serre du CNRS en 2022.
Des initiatives telles que l’accompagnement des laboratoires pour favoriser la mutualisation des ressources et l’achat collectifs de consommables sont mises en avant. De plus, un centre de compétences en durabilité est en projet pour étendre la portée des actions du CNRS vers d’autres champs de la transition.
Élargir la portée de l’impact environnemental
Le CNRS ne se limite pas à la réduction de l’empreinte carbone mais adopte une approche holistique de l’impact environnemental. Cela inclut l’étude et la gestion des impacts sur les sols, la biodiversité, la ressource en eau, ainsi que la maîtrise des pollutions et des déchets. Cette approche diversifiée permet au CNRS de se préparer face aux défis de l’adaptation au changement climatique tout en œuvrant pour l’atténuation des impacts. La nécessité d’anticiper les risques est souligne par Antoine Petit, qui insiste sur le fait que les mesures d’adaptation sont cruciales pour maintenir le potentiel scientifique et technique de l’organisme.
Un engagement vers le bien-être des agents
Antoine Petit insiste également sur le fait que le succès de cette transition passe nécessairement par le bien-être des agents. Le CNRS prévoit d’identifier et de développer de nouvelles compétences clés pour accompagner la transformation des métiers et renforcer l’engagement des agents dans les transitions sociétales. En effet, à mesure que le monde évolue, il est essentiel d’adapter les compétences et les savoir-faire des employés aux nouveaux enjeux environnementaux.
L’emphase sur la qualité de vie au travail, la sécurité et la santé, est également centrale dans la démarche d’adaptation du CNRS face aux défis globaux. Une approche intégrée et systémique est donc mise en place, permettant de répondre aux besoins des agents tout en poursuivant les objectifs de durabilité.
Repenser les pratiques de recherche
Le schéma DD&RS encourage le CNRS à repenser ses pratiques de recherche à l’échelle collective. Ce cadre invite à une réflexion critique sur les impacts environnementaux tout au long de la chaîne de valeur de la recherche, allant de son élaboration à sa valorisation. Ce processus permet d’intégrer une dimension d’éthique environnementale à chaque étape, ce qui est essentiel pour un projet de recherche durable et responsable.
En favorisant ainsi une collaboration active entre les différents acteurs, du personnel de recherche jusqu’aux instances dirigeantes, le CNRS travaille à construire un avenir où les enjeux environnementaux et sociétaux sont au cœur des préoccupations de tous. Cet engagement fort définit le rôle des chercheurs comme non seulement générateurs de connaissance mais également comme acteurs de changement.
Pour plus d’informations sur les initiatives du CNRS en matière d’impact écologique et d’engagement sociétal, vous pouvez consulter les liens suivants : Initiatives écologiques, Bilan carbone, Transition environnementale, Technologie AUSEA, Plan de transition, Acteur de la transition, Pilier pour une transition durable, Acteur clé dans l’écologie, Place de l’écologie, Pilier incontournable.
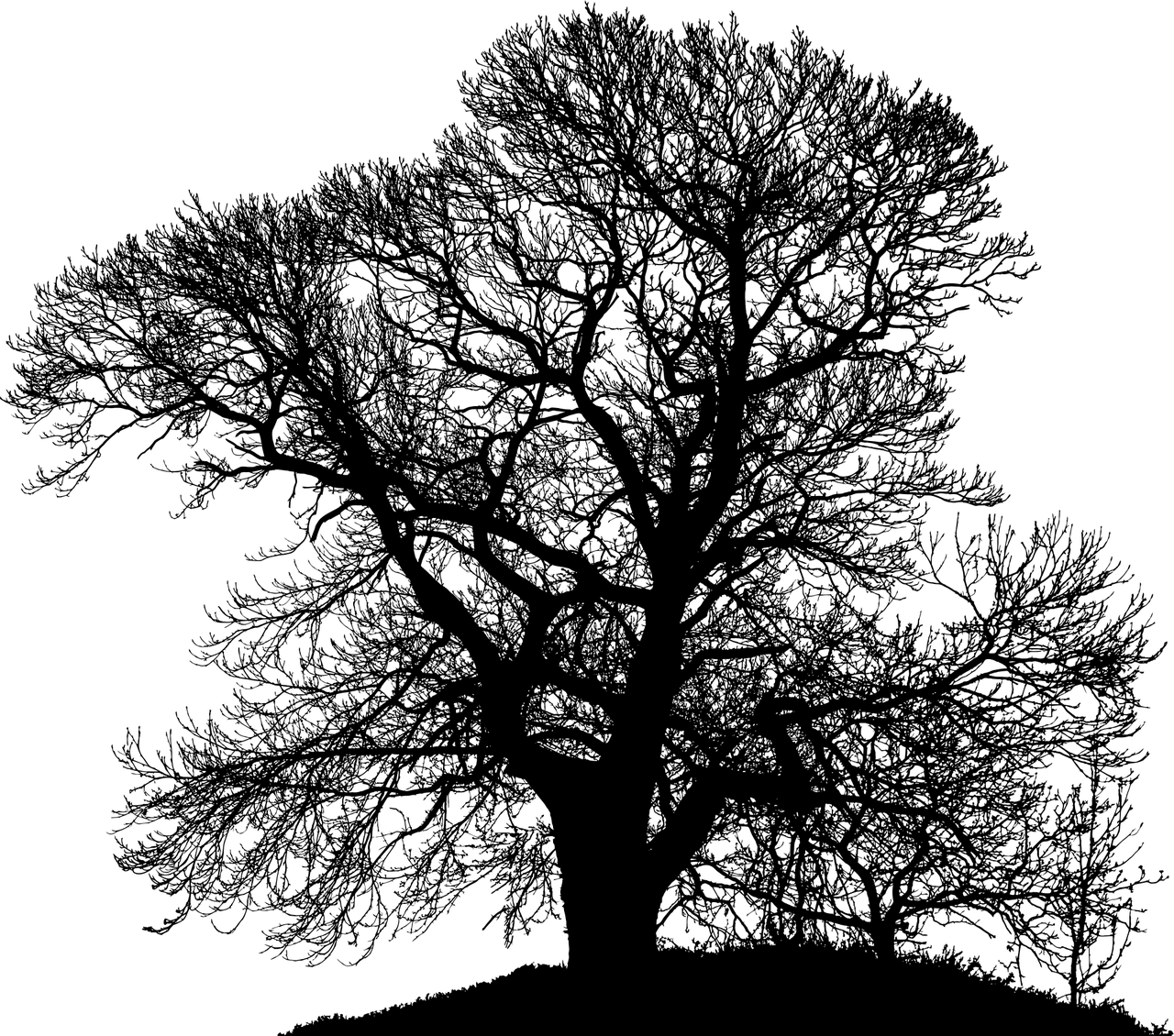
Le CNRS : Pilier de la Transformation Écologique et de l’Engagement Sociétal
Antoine Petit souligne l’importance de l’interconnexion entre la dimension environnementale et la dimension humaine des transitions socio-écologiques. Selon lui, les enjeux environnementaux ne peuvent être dissociés des questions d’organisation du travail et de dialogue social. Au CNRS, l’objectif est de mener des recherches d’excellence tout en adoptant une approche durable qui améliore notre qualité de vie au travail.
La récente publication du schéma directeur développement durable et responsabilité sociétale (DD&RS) représente une étape clé pour ancrer cette volonté dans les pratiques de l’organisme. Ce document, élaboré de manière collégiale, propose une feuille de route pour les actions à mener entre 2025 et 2027, et vise à structurer les efforts du CNRS en faveur de la transition environnementale.
Ayant pris conscience de l’impact environnemental de ses activités, le CNRS suit une feuille de route développement durable depuis 2020, qui s’est vu enrichie par un plan de transition bas carbone en 2023. Ce plan est le fruit d’une Évaluation des émissions de gaz à effet de serre, permettant à l’institution d’agir de manière proactive et d’engager une réflexion collective sur ses responsabilités envers la planète.
Les initiatives du CNRS s’étendent également à la responsabilité sociétale. Antoine Petit affirme que l’institution s’investit depuis des années dans les ressources humaines pour répondre aux attentes de ses agents, en promouvant l’égalité professionnelle et la diversité. Cette politique a été reconnue au niveau européen, témoignant de l’engagement du CNRS envers des pratiques éthiques et inclusives.
Le schéma DD&RS s’articule autour de quatre axes fondamentaux : stratégie et gouvernance, recherche et innovation, environnement, et politique sociale. En intégrant plus d’une centaine d’actions interconnectées, ce plan met en avant l’importance de l’approche systémique pour maximiser les co-bénéfices et éviter les contradictions.
Les engagements du CNRS visent à anticiper les risques environnementaux et à accompagner ses agents dans cette démarche. En identifiant et en développant de nouvelles compétences, l’institution souhaite non seulement répondre aux enjeux de transitions, mais aussi promouvoir le bien-être des agents, soulignant l’importance d’un environnement de travail qui favorise la qualité de vie.
Enfin, Antoine Petit souligne que le schéma DD&RS doit inviter à une réflexion collective sur les practices de recherche. Il est essentiel de renforcer la recherche sur les impacts environnementaux et d’impliquer tous les acteurs, depuis les individus jusqu’aux instances dirigeantes, afin d’intégrer l’éthique environnementale dans chaque projet de recherche. Ce faisant, le CNRS témoigne de son rôle de leader dans la transition vers un avenir durable.