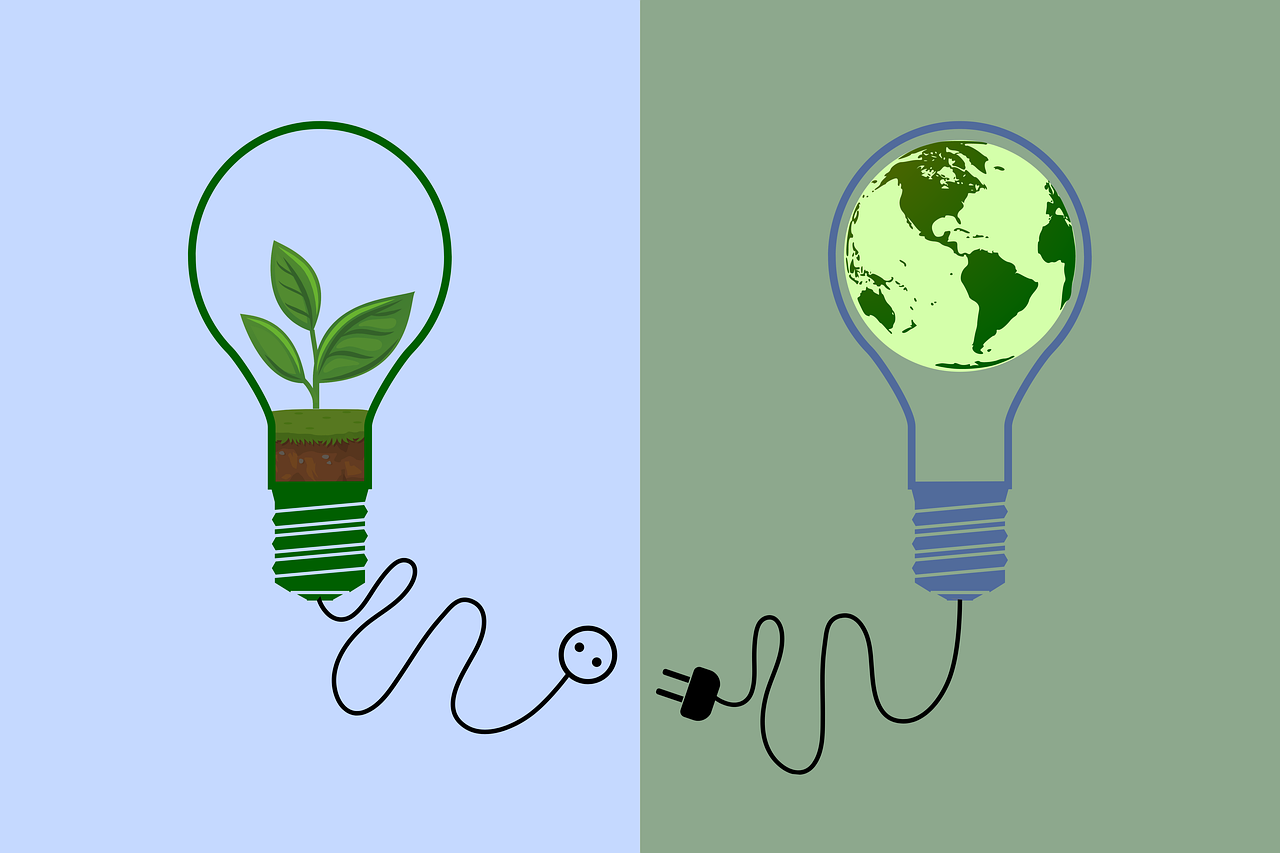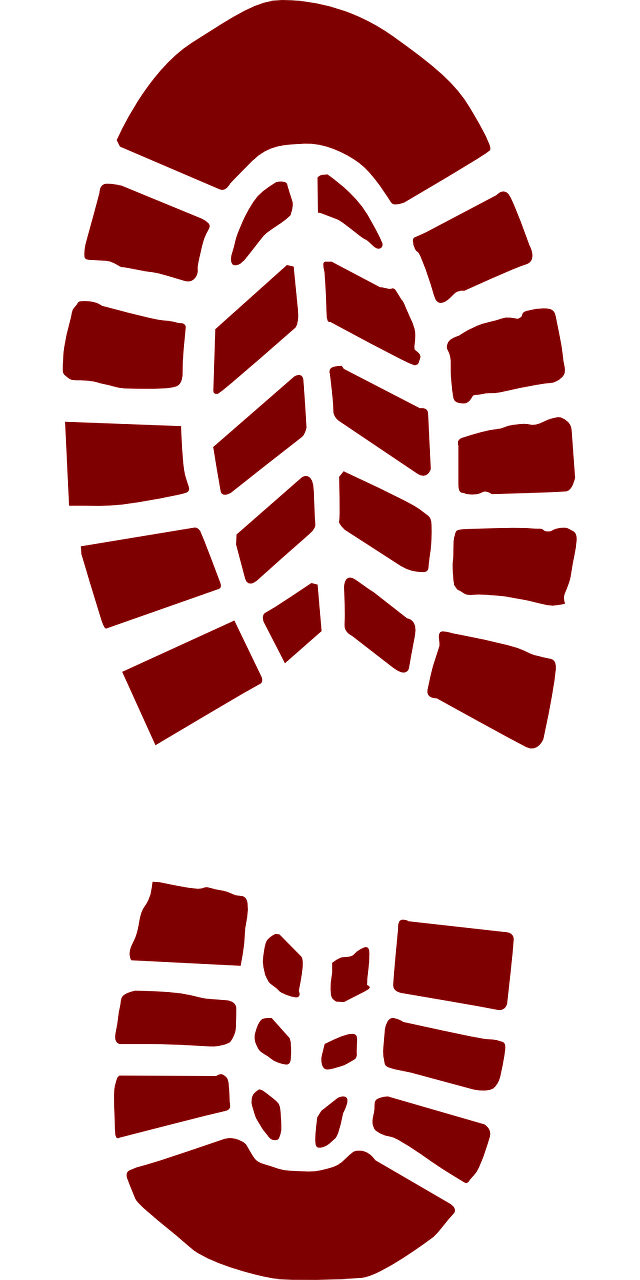|
EN BREF
|
Le 3e colloque de Labos 1point5, qui s’est tenu à Paris et en ligne, a mis en lumière l’importance de réduire l’impact environnemental des activités de recherche. Les laboratoires sont souvent énergivores et liés à des déplacements fréquents, mais ils peuvent également jouer un rôle clé dans la transition écologique. Le groupement de recherche Labos 1point5, actif depuis 2021, a présenté des outils permettant aux chercheurs de mesurer leur empreinte carbone et d’agir pour la réduire. Trois axes principaux – empreinte, transition et enseignement – ont été développés de manière collaborative pour faciliter l’engagement des laboratoires. Ce colloque a également souligné la nécessité d’une coopération entre scientifiques et administrateurs pour accompagner efficacement cette transformation écologique.
La nécessité d’adopter des pratiques de recherche écoresponsables ne fait plus débat dans la communauté scientifique. La recherche, souvent perçue comme un acteur du progrès, doit également assumer son impact environnemental, qui se révèle conséquent. Ainsi, l’objectif devient clair : réfléchir à comment la recherche peut non seulement contribuer à la protection de l’environnement mais aussi à son propre bon fonctionnement. Cet article traite des actions menées pour réduire l’impact environnemental des activités de recherche, des outils développés pour évaluer cet impact, et des défis à relever pour instaurer une culture de la durabilité au sein des laboratoires de recherche.
Les enjeux de la recherche écoresponsable
La recherche scientifique est souvent gourmande en ressources : énergie, matières premières, déplacements… Le constat est implacable : l’empreinte carbone des laboratoires est élevée. D’après des études, les achats scientifiques représentent une part souvent négligée du bilan d’émissions de gaz à effet de serre des institutions de recherche, dépassant parfois l’impact des déplacements. Cela nécessite une prise de conscience et une action concertée pour réduire cet impact, notamment à travers des initiatives visant à évaluer et à réduire les émissions.
Les actions concrètes dans la recherche
Création de groupements de recherche
Des initiatives telles que le groupement de recherche Labos 1point5 ont vu le jour pour structurer une réflexion autour de la transition écologique en recherche. Ce groupement a pour but de soutenir les acteurs de la recherche dans leur engagement à réduire leur empreinte écologique. Les différentes actions entreprises visent aussi bien à analyser les pratiques actuelles qu’à proposer des solutions concrètes.
Outils d’évaluation et de suivi
Pour réaliser un état des lieux de l’impact environnemental, plusieurs outils ont été développés. Le GES 1point5, par exemple, permet aux laboratoires de calculer leurs émissions de gaz à effet de serre. Plus de 1000 laboratoires en France utilisent déjà cet outil, permettant un partage de données essentiel pour établir des bilans d’émission. Ces outils ont pour but non seulement d’établir un constat, mais aussi de servir de bases pour des actions de transition.
Les axes de travail du GDR
Axe “empreinte”
L’un des axes principaux du groupement est l’axe “empreinte”, qui œuvre à mesurer et à caractériser l’impact environnemental des activités de recherche. Ce travail est crucial pour comprendre d’où proviennent les émissions et comment elles pourraient être réduites efficacement. Il s’agit d’un axe fondamental pour établir des priorités et élaborer des stratégies de transition.
Axe “transition”
Un autre axe de travail important est celui de la transition, dédié à la mise en mouvement des laboratoires. Cet axe se concentre sur l’identification des freins et leviers liés à la transition, qu’ils soient sociaux, comportementaux ou organisationnels. L’objectif est de créer un climat propice à l’adoption de pratiques de recherche écoresponsables, en analysant ce qui fonctionne et ce qui doit être amélioré.
Axe “enseignement”
Le dernier axe, celui de l’enseignement, se consacre à la formation des futurs chercheurs et techniciens. Il s’agit d’intégrer des connaissances sur la durabilité et les enjeux écologiques dans les cursus universitaires, afin de former une nouvelle génération d’élèves conscients des défis environnementaux. Ce partage de savoirs est indispensable pour préparer le monde de la recherche à évoluer vers des pratiques plus durables.
Les défis à relever
Problématiques d’approvisionnement
Un des défis majeurs pour les laboratoires est l’analyse des cycles de vie des différents achats. Notre actuelle nomenclature, par exemple, n’est pas optimisée pour la comptabilité carbone, ce qui limite la précision de l’évaluation de l’impact environnemental. Les efforts doivent donc se concentrer sur l’amélioration de cette nomenclature afin de mieux identifier les achats écoresponsables.
Freins comportementaux et culturels
Il est également crucial de traiter les freins psychologiques et sociaux qui peuvent empêcher une transition effective. Les chercheurs, bien que conscients des enjeux de durabilité, peuvent parfois hésiter à modifier leurs pratiques établies. Cela souligne l’importance d’un débat collectif au sein des communautés scientifiques pour discuter des possibilités de changement et des priorités de recherche.
Rôle des infrastructures de recherche
Les grandes infrastructures de recherche, telles que les accélérateurs de particules ou les télescopes, présentent également un impact environnemental qu’il est crucial d’étudier. Leur usage, même limité à un petit nombre de chercheurs, peut dominer le bilan carbone d’un laboratoire. Ce constat invite à entrer dans une réflexion plus générale sur la planification et le lancement de nouvelles infrastructures en prenant en compte leur impact environnemental.
Contributions aux politiques publiques
Les résultats des travaux du GDR peuvent également éclairer les décisions politiques concernant la recherche et l’environnement. En effet, en s’appuyant sur des données solides, le groupement peut fournir des recommandations pratiques pour l’élaboration de politiques publiques qui favorisent la durabilité dans le secteur scientifique. Le passage de l’analyse à l’action est d’une importance cruciale pour que la recherche contribue à un avenir plus durable.
Une communauté engagée
La structuration en groupements de recherche permet d’organiser une communauté de recherche mais également d’enseignement. Cela encourage les échanges entre les différents acteurs et favorise l’adoption de meilleures pratiques. Le partage des connaissances et des expériences devient clé pour avancer dans la transition vers une recherche écoresponsable.
Collaboration interdisciplinaire
Un autre aspect essentiel est l’ouverture vers d’autres disciplines, telles que les sciences humaines et sociales, qui peuvent offrir des perspectives différentes sur les enjeux environnementaux. Cette interdisciplinarité est fondamentale pour aborder les défis de manière holistique et trouver des solutions innovantes qui intègrent différentes approches.
Vers un futur durable
Il est urgent que les laboratoires et institutions de recherche prennent conscience de leur impact écologique et s’engagent dans une démarche de durabilité. La recherche écoresponsable ne doit pas être perçue comme une contrainte, mais comme une opportunité d’innover dans la manière dont la recherche est menée. L’évaluation systématique de l’impact de la recherche et l’adoption de pratiques durables deviennent les piliers d’un parcours évolutif vers un engagement responsable.
Les différentes actions et outils développés dans le cadre de groupes comme Labos 1point5 montrent une voie prometteuse vers une recherche scientifique durable. Cependant, pour que cela devienne une réalité, il est essentiel que chaque acteur prenne part à cette transition, engageant les futurs chercheurs à adopter des pratiques conscientes et responsables.
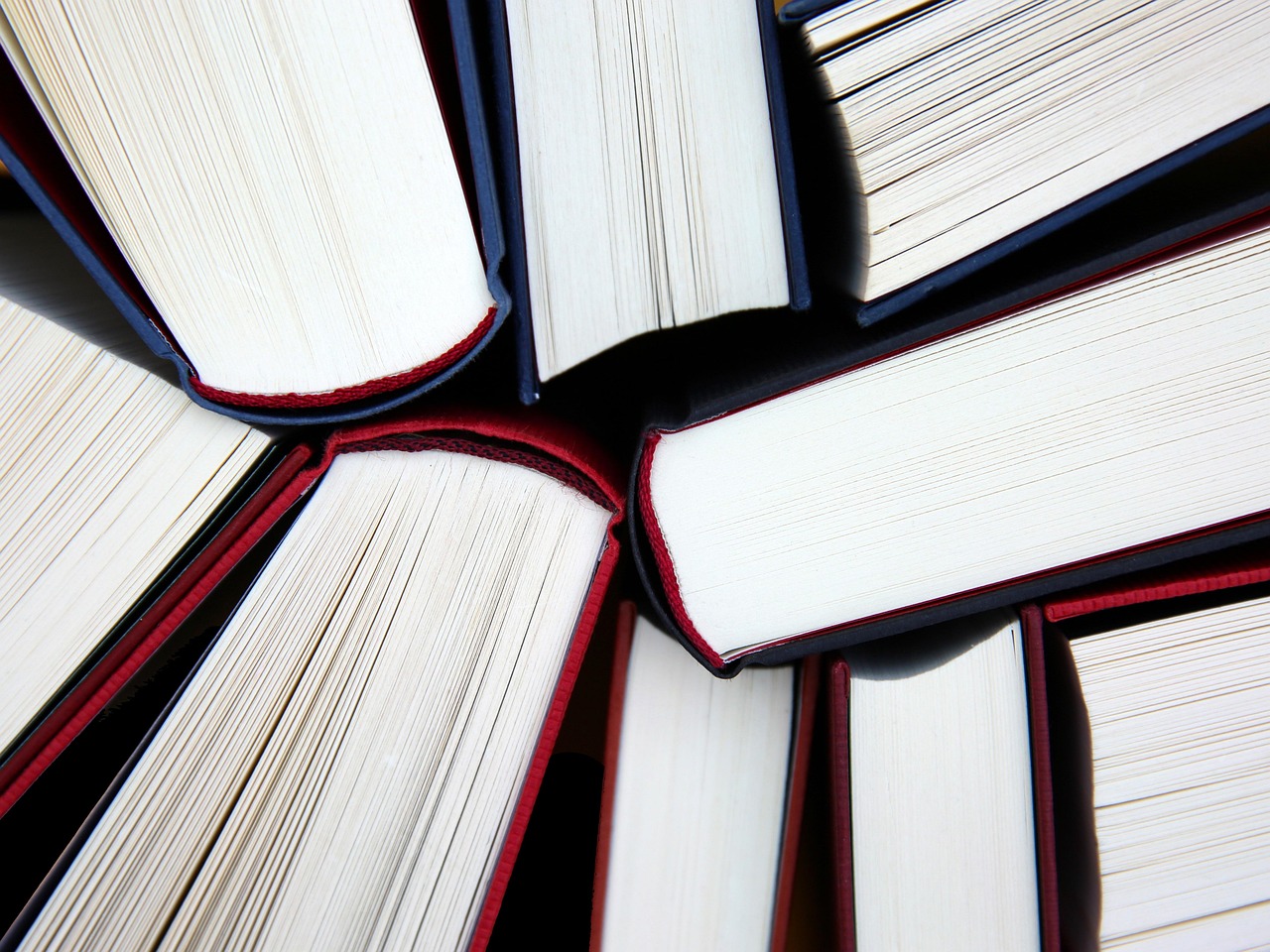
La recherche scientifique est essentielle pour le progrès de notre société, mais elle engendre également un impact environnemental significatif. C’est pourquoi le groupement de recherche Labos 1point5 a pris l’initiative de questionner les pratiques au sein des laboratoires afin d’identifier des solutions pratiques pour réduire cet impact. Ce processus d’introspection a pu donner lieu à de nombreux témoignages éclairants.
Mélissa Ridel, professeure à Sorbonne Université, témoigne : « En tant que chercheuse engagée dans le développement durable, je réalise à quel point il est essentiel d’étudier l’empreinte environnementale de notre travail. Il ne s’agit pas seulement de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de repenser nos méthodes de recherche pour qu’elles soient plus durables. »
Un autre membre de l’équipe, André Estevez-Torres, ajoute : « La lutte contre les dérives environnementales de nos pratiques scientifiques est un défi que nous devons relever collectivement. Chez Labos 1point5, nous avons la chance d’avoir une communauté qui partage cette vision, ce qui nous permet de lancer des initiatives innovantes. »
Pour Stéphane Guillot, délégué scientifique au CNRS, la transition vers une recherche plus écoresponsable repose sur une collaboration entre les directions et les agents sur le terrain : « Il est crucial que les décisions concernant l’environnement soient basées sur la réalité du quotidien des laboratoires. C’est l’union de nos perspectives qui peut engendrer des changements significatifs. »
Un étudiant engagé dans le programme indique : « J’apprends qu’il existe des outils pour quantifier notre impact écologique. Grâce à ces données, nous pouvons agir de manière informée et responsable. La recherche ne se cantonne pas à l’élaboration de théories, elle doit également se traduire par des actions concrètes pour l’environnement. »
Les outils développés par Labos 1point5 comme GES 1point5 et Scénario 1point5 sont des véritables leviers pour les laboratoires. Un chercheur passionné par cette transition précise : « Ces outils sont non seulement efficaces pour le suivi des émissions, mais aussi pour envisager des stratégies de réduction adaptées, rendant notre contribution à la science plus respectueuse de l’environnement. »
Les témoignages recueillis soulignent unanimement que la recherche écoresponsable n’est pas une option, mais un impératif. Chaque acteur, qu’il soit enseignant, étudiant ou chercheur, a un rôle à jouer dans cette transformation nécessaire et positive. La responsabilité environnementale doit devenir la norme dans chacun de nos projets scientifiques, contribuant ainsi à un avenir durable.