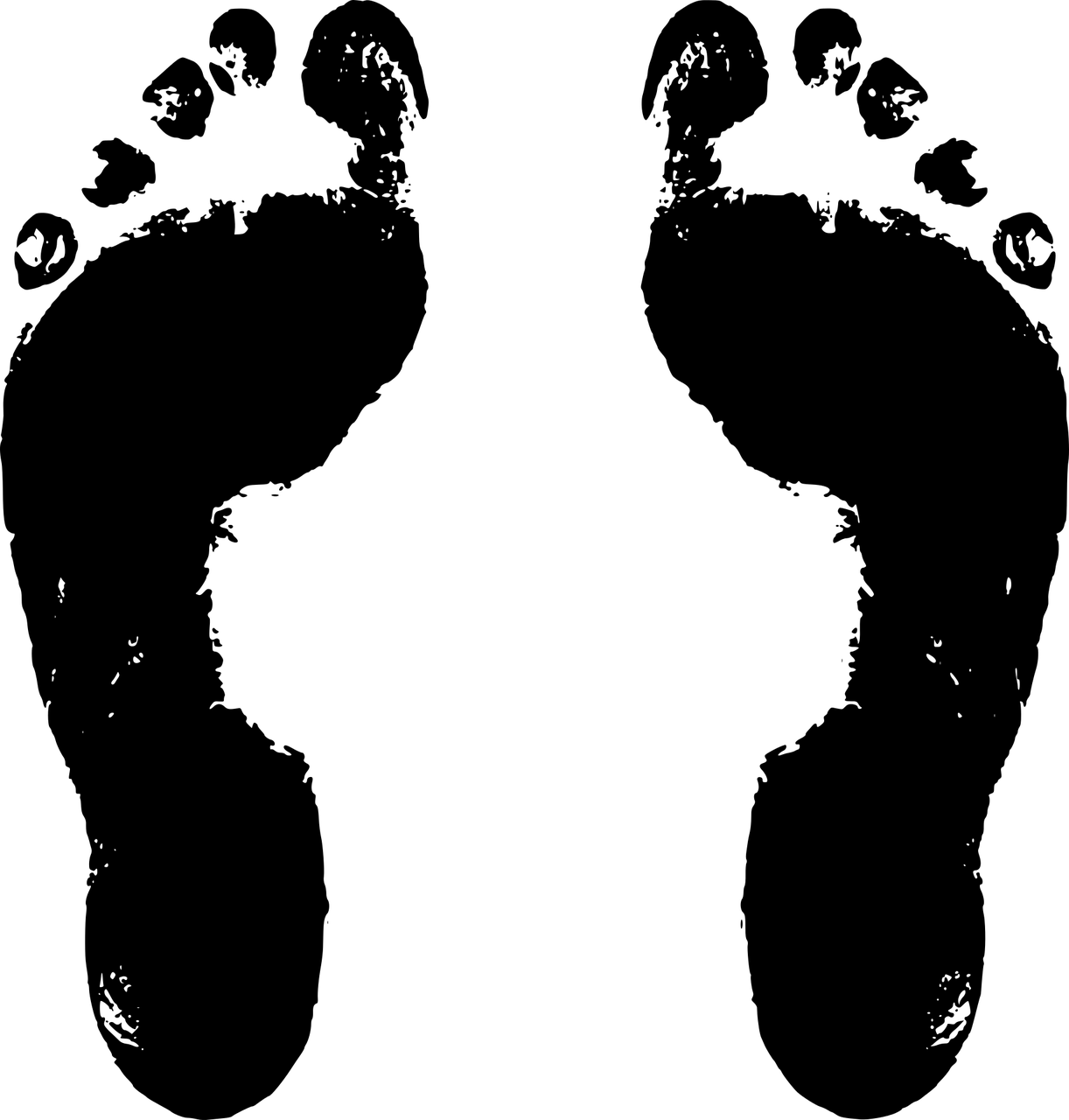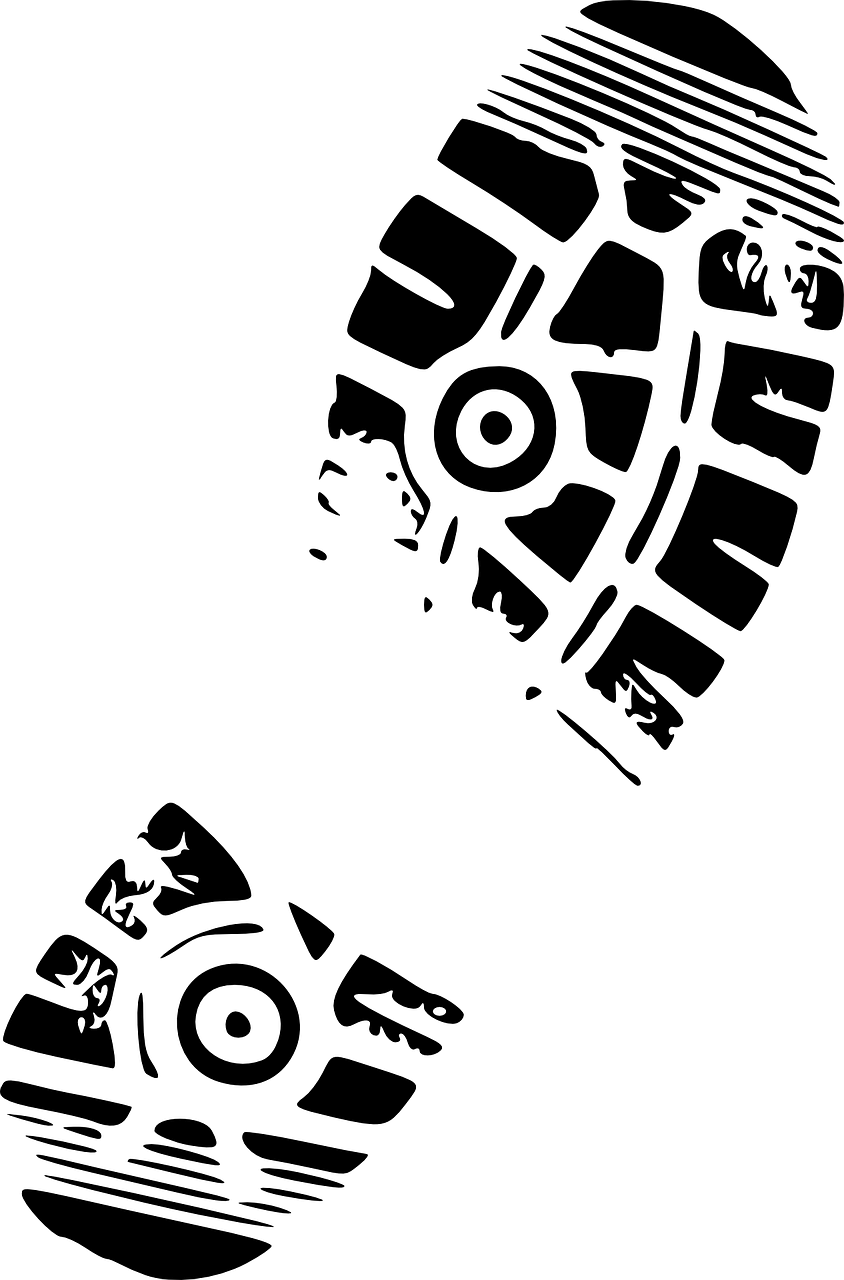|
EN BREF
|
Face au changement climatique, les acteurs du tennis mondial commencent à agir, mais leurs initiatives restent fragmentées plutôt qu’organisées autour d’une stratégie globale. Sur le circuit masculin, l’ATP a lancé son premier rapport sur le développement durable, affichant un bilan carbone de 6.381 tonnes équivalent CO2 pour 2023 et visant à réduire ses émissions de 50% d’ici 2030. En revanche, la WTA, sans rapport chiffré, privilégie le dialogue et encourage des pratiques écoresponsables, tandis que l’ITF travaille sur la durabilité des équipements sans publier de chiffres concrets pour les grandes compétitions. Enfin, les tournois du Grand Chelem se sont engagés dans une initiative de l’ONU pour améliorer leur responsabilité environnementale, mais la multitude d’organes décisionnaires complique la mise en œuvre d’une vision unifiée.
Le monde du tennis est en pleine mutation face à l’urgence du changement climatique, mais les initiatives mises en œuvre semblent souvent plus fragmentées que concertées. Qu’il s’agisse de l’ATP, de la WTA, des tournois du Grand Chelem ou de l’ITF, chaque entité adopte des approches différentes, allant d’évaluations d’émissions à des efforts d’écoresponsabilité, sans coordination globale. Dans cet article, nous examinerons les diverses actions entreprises par les acteurs du tennis professionnel et mettrons en lumière le besoin crucial d’une stratégie unifiée pour lutter efficacement contre la crise climatique.
Le contexte des émissions de carbone dans le tennis
Au cœur des préoccupations environnementales, les bilans carbone sont devenus des outils indispensables pour évaluer l’impact des activités humaines, y compris sportives. Dans le tennis, les déplacements fréquents des joueurs, des équipes et des spectateurs contribuent considérablement aux émissions de gaz à effet de serre. La nécessité d’adopter des pratiques plus durables s’impose donc, mais il est évident que le chemin vers une neutralité carbone nécessite des efforts conjoints et synchronisés qui font encore défaut.
Les efforts de l’ATP : un premier rapport positif mais insuffisant
Sur le circuit masculin, l’ATP (Association of Tennis Professionals) a dévoilé à l’été 2024 son premier rapport sur le développement durable. Ce document évalue pour la première fois les émissions de carbone liées à ses activités, sauf celles causées par les déplacements des joueurs. Pour l’année 2023, l’ATP affiche un bilan de 6.381 tonnes de CO2, soit une hausse de 58% par rapport à l’année précédente. Un objectif ambitieux de réduction de 50% des émissions d’ici 2030 a été fixé, ainsi qu’une neutralité carbone d’ici 2040.
Pour encourager les joueurs à prendre conscience de leur empreinte carbone, l’ATP a lancé l’application « Carbon Tracker » en 2023. Cette application permet aux joueurs de mesurer les émissions générées lors de leurs voyages et de les compenser en investissant dans des projets écologiques. Cependant, malgré un début prometteur avec 201 utilisateurs rapportant leurs trajets, le nombre a chuté l’année suivante à un peu plus de 100 participants, démontrant ainsi la nécessité d’une incitation continue pour maintenir l’engagement.
WTA : une approche axée sur le dialogue et les incitations
Contrairement à ses homologues masculins, la WTA (Women’s Tennis Association) n’a pas publié de rapport de développement durable. Au lieu de cela, l’organisation mise sur le dialogue avec les joueuses et les organisateurs de tournois, cherchant à encourager des comportements écoresponsables sans imposer de contraintes strictes. Parmi les actions recommandées, on trouve la réduction de l’utilisation de plastiques à usage unique, l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques et la redistribution des repas non consommés à des associations caritatives.
Les joueuses sont également encouragées à privilégier l’utilisation de gourdes plutôt que de bouteilles en plastique et à choisir des hébergements respectueux de l’environnement. En France, le tournoi WTA 500 de Strasbourg s’est engagé dans la mesure de ses émissions de carbone depuis 2009 et a mis en place des initiatives pour favoriser l’utilisation de moyens de transport écologiques, comme la déduction du prix du ticket de transport public du montant du billet d’entrée au tournoi.
L’ITF et ses initiatives pour la durabilité
La Fédération Internationale de Tennis (ITF), responsable de la Coupe Davis et de la Billie Jean King Cup, voit également l’urgence d’agir. En 2022, elle a publié un premier bilan carbone pour l’année 2021, ne prenant toutefois pas en compte les émissions générées par ses compétitions phares. Bien qu’elle ait mesuré les émissions des éditions suivantes, elle préfère ne pas encore les publier, se considérant encore « dans une phase d’apprentissage ».
En parallèle, l’ITF a constitué un groupe de travail sur la durabilité des équipements, unissant plusieurs équipementiers et les Fédérations françaises (FFT) et américaines (USTA) pour explorer des solutions durables. Parmi leurs efforts, la création de modèles de balles plus durables et le développement de prototypes sont notables. Leur collaboration avec d’autres disciplines sportives vise également à trouver des solutions pour le réemploi et le recyclage des fibres de carbone.
Les Grands Chelems : un engagement collectif pour la responsabilité environnementale
L’Open d’Australie, Roland-Garros, Wimbledon et l’US Open ont tous adhéré en 2019 à l’initiative de l’ONU, le « Cadre de l’action climatique dans le sport ». Cet engagement vise à promouvoir la responsabilité environnementale, à réduire l’empreinte écologique et à encourager les comportements durables parmi les acteurs du tennis. Cependant, malgré ces engagements, l’absence d’une stratégie harmonisée demeure une préoccupation. Claire Hallé, responsable RSE de la FFT, souligne que la fragmentation de la gouvernance rend difficile une action coordonnée.
Un manque de stratégie globale et ses répercussions
Le théâtre des initiatives écologiques dans le tennis révèle une mosaïque d’efforts souvent isolés. Si chaque organisation lance des projets auxquels elle croit, le manque d’une vision commune et de coopération entre les entités crée une cacophonie qui affaiblit l’impact des actions menées. Les efforts de réduction des émissions de l’ATP, les initiatives de la WTA et les projets de l’ITF ne sont pas synchronisés et cela peut mener à une dilution de l’efficacité globale. Une stratégie globale pourrait non seulement maximiser l’impact des actions mises en œuvre, mais aussi fédérer davantage les acteurs autour d’un objectif commun.
L’écoresponsabilité comme atout marketing
Investir dans des pratiques écoresponsables peut représenter un coût au départ, mais cela se transforme en atout marketing à long terme. Comme l’illustre le tournoi WTA 500 de Strasbourg, où le directeur Denis Naegelen a souligné que ces mesures deviennent par la suite bénéfiques. En temps de prise de conscience croissante des enjeux environnementaux, les consommateurs sont de plus en plus sensibles aux choix faits par les marques et les organisations. Ainsi, ceux qui s’engagent activement pour la durabilité pourraient se démarquer sur le marché.
Conclusion du débat sur la durabilité dans le tennis
Le débat sur la durabilité au sein du tennis professionnel expose à la fois des avancées encourageantes et de réelles lacunes. Si certains acteurs prennent des initiatives positives, le manque de coordination et d’efforts unifiés compromet l’effet des actions. La communauté du tennis doit urgemment réfléchir à une stratégie globale pour faire face au changement climatique et réellement faire une différence dans ce combat.
Pour en savoir plus sur ces initiatives, découvrez les actualités sur le développement durable par la FFT, ainsi que les réflexions sur les efforts isolés face à un défi global sur Blewbury Climate Action. Des insights sur l’engagement environnemental des tournois comme Roland-Garros sont disponibles sur Brinkman Climate Change. Vous pouvez également lire l’analyse des implications climatiques dans le tennis sur DD Mineurs, ou consultez l’évaluation de l’empreinte carbone dans le sport sur Brinkman. Enfin, une perspective plus large sur la transition vers la durabilité dans le tennis professionnel peut être trouvée sur Courts Club.

Le tennis mondial est conscient de l’impact du changement climatique, mais les actions entreprises semblent souvent fragmentées et désordonnées. Chaque organisation, que ce soit l’ATP, la WTA ou l’ITF, agit selon ses propres priorités sans réelle coordination entre elles.
L’ATP a récemment pris des mesures notables, ayant publié en 2024 son premier rapport sur le développement durable. Malgré l’augmentation de 58% de ses émissions de gaz à effet de serre en 2023, elle vise une réduction de 50% de ces émissions d’ici 2030. Cependant, l’exclusion des déplacements des joueurs, pour lesquels les émissions sont significatives, soulève des questions sur la véritable portée de ces engagements.
De son côté, la WTA privilégie le dialogue et l’incitation, en encourageant les tournois à adopter des pratiques durables comme réduire l’usage du plastique ou installer des bornes de recharge. Toutefois, l’absence d’un rapport formel et de bilans chiffrés sur leurs émissions renforce l’impression d’une action peu cohérente.
La Fédération internationale de tennis (ITF) a également publié un bilan carbone, mais sans inclure des compétitions majeures comme la Coupe Davis. Cette approche empêche d’obtenir une vision d’ensemble des impacts environnementaux du tennis international. Alors que des groupes de travail pour la durabilité des équipements ont été institués, le manque de publication de données laisse les parties prenantes dans le flou quant aux résultats obtenus.
Les tournois du Grand Chelem se sont engagés à réduire leur empreinte écologique en répondant aux directives de l’ONU, mais leur organisation éclatée rend difficile la mise en œuvre d’une stratégie commune. Bien qu’ils échangent régulièrement sur ces sujets, le manque d’une vision unifiée risque de nuire à l’efficacité des actions menées.
En somme, alors que les acteurs du tennis mondial commencent à se mobiliser face à l’urgence climatique, leurs efforts demeurent souvent isolés. Sans une stratégie globale et une coordination efficace, les actions contre le changement climatique risquent de rester insuffisantes pour faire une réelle différence.