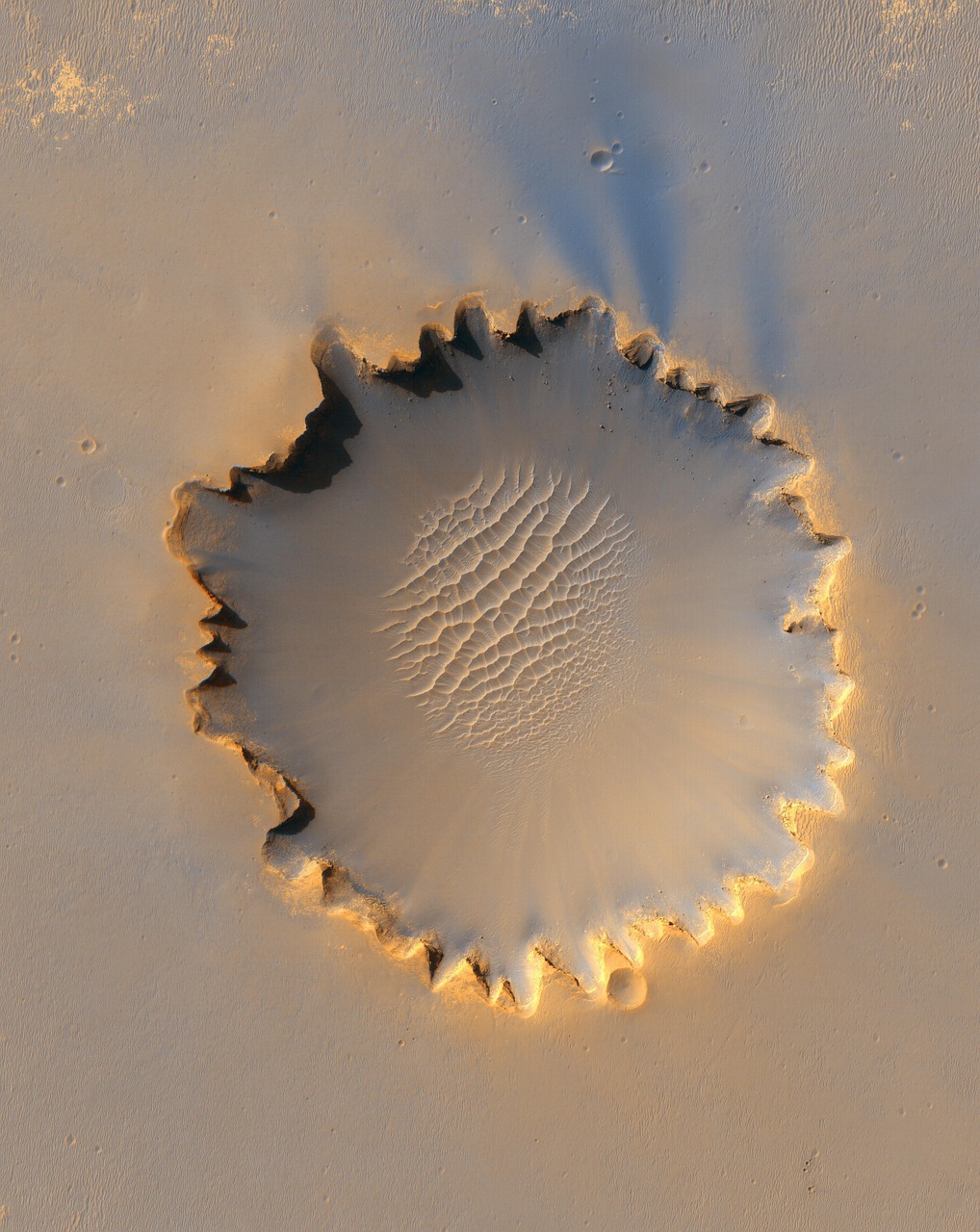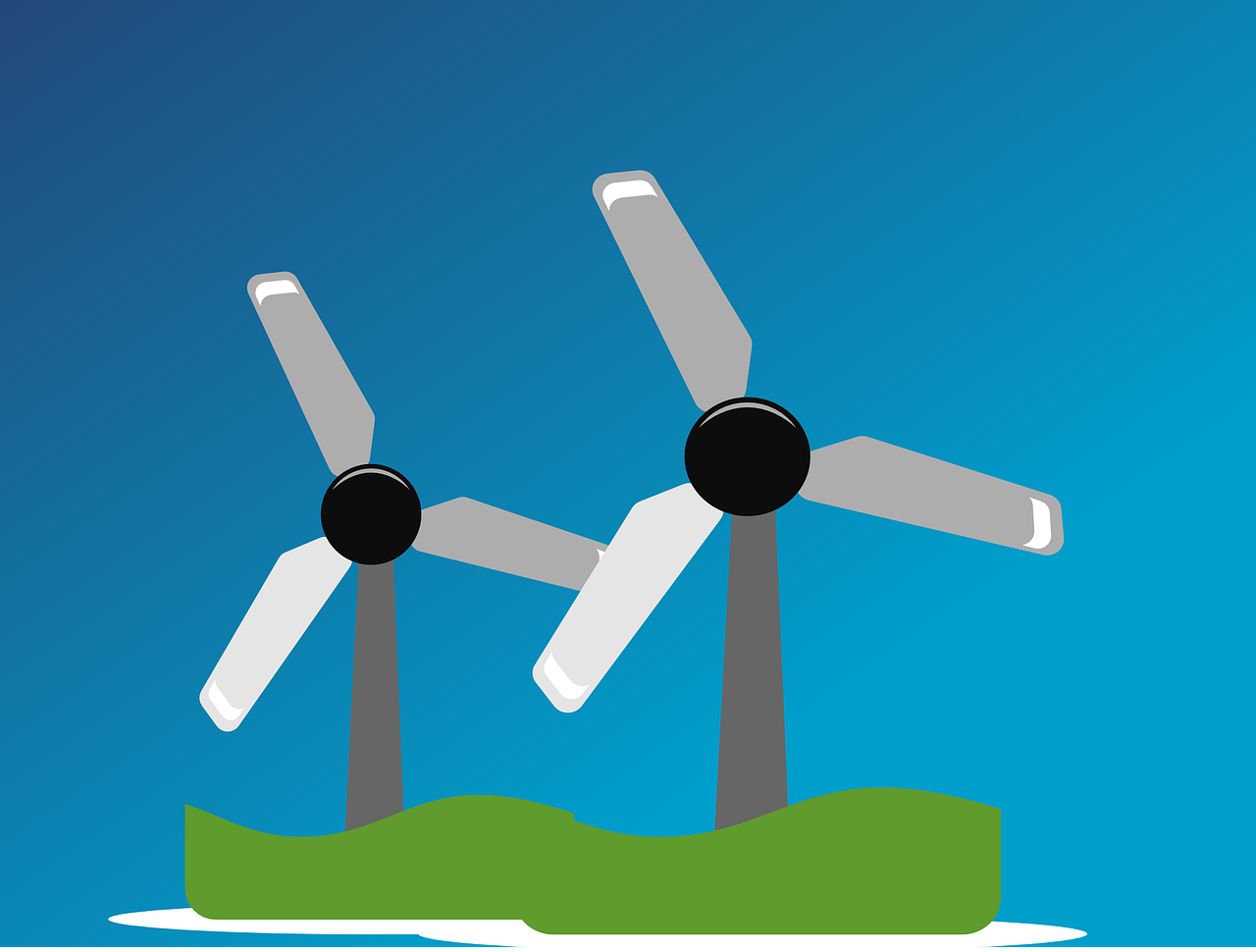|
EN BREF
|
Une nouvelle étude commandée par la direction générale de la création artistique et réalisée par le cabinet PwC met en lumière l’empreinte carbone du secteur artistique en France. Elle révèle que les émissions de gaz à effet de serre (GES) du domaine subventionné sont estimées à 400 kilotonnes de CO²e par an, représentant environ 5% des émissions totales du secteur créatif. Grâce à cette évaluation, l’empreinte totale du secteur est jugée à 8,5 millions de tonnes de CO²e par an, soit 1,3% des émissions nationales. Cette étude a également identifiée les principaux postes d’émissions, tels que la mobilité des spectateurs, qui constitue 38% des émissions dans le spectacle vivant, tandis que dans les arts visuels, cette part atteint 65%. Ces données soulignent l’urgence d’agir pour réduire l’impact environnemental de la création artistique et motivent une démarche collective vers une transformation écologique du secteur.
Dans un monde de plus en plus conscient des enjeux environnementaux, une étude innovante a été mise en place pour évaluer l’empreinte carbone de la création artistique. Menée par le ministère de la Culture en France, cette recherche met en lumière l’impact environnemental potentiel des pratiques artistiques, allant des spectacles vivants aux arts visuels. Ce travail cherche non seulement à comprendre les émissions de gaz à effet de serre générées par ce secteur, mais aussi à promouvoir des actions concrètes pour réduire cet impact, rendant ainsi la création artistique plus durable.
L’initiative du ministère de la Culture
Cette étude a été réalisée sous l’égide de la direction générale de la création artistique, dans le cadre d’un engagement vers des pratiques plus responsables. Les objectifs de cette initiative s’inscrivent dans les lignes directrices établies par le ministère de la Culture, qui vise à sensibiliser le secteur sur l’importance de l’intégration des préoccupations écologiques dans la création artistique.
Le ministère a fait appel au cabinet PwC (Price Waterhouse Coopers) pour mener à bien cette évaluation. En collaboration avec des structures comme le Département des études, de la prospective, des statistiques et de la documentation (DEPS-DOC), des données précises ont été collectées pour aboutir à une analyse significative.
Une collecte de données exhaustive
Pour fournir des résultats fiables, l’étude s’est basée sur une approche collective réunissant divers acteurs du secteur. Les associations professionnelles de 11 labels, ainsi que 5 réseaux de la création, ont collaboré à cette mission. Cela comprend des équipes artistiques et des festivals, ce qui renforce la représentativité de l’échantillon étudié.
Au total, plus de 100 bilans carbone ont été réalisés, permettant de toucher à différentes facettes du secteur artistique. Ces bilans ont été conçus dans le cadre d’une démarche de référentiels carbone, ayant pour but d’aider les organismes subventionnés à mesurer et réduire leur empreinte environnementale.
Formation et sensibilisation
Un volet essentiel de cette étude a été l’éducation des équipes artistiques au sujet des enjeux liés à l’énergie et au climat. De nombreuses sessions de formation ont été organisées, abordant des thèmes tels que l’écoconception, la mobilité durable et l’utilisation d’énergies renouvelables. Cette sensibilisation est cruciale pour encourager des pratiques de création plus responsables, permettant aux professionnels de prendre des décisions éclairées vis-à-vis de leur impact environnemental.
Les résultats de l’étude
Les résultats de cette première étude sur l’impact carbone de la création artistique sont à la fois révélateurs et préoccupants. L’évaluation des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le secteur subventionné a mis en avant une estimation de 400 kilotonnes de CO²e par an. Cela représente environ 5% des émissions totales de l’ensemble de la création artistique, qui englobe le spectacle vivant, les arts visuels et l’enseignement supérieur artistique.
Pour mieux contextualiser ces chiffres, il est bon de les comparer à d’autres secteurs connexes. Par exemple, les galeries d’art émettent environ 254 kilotonnes de CO²e, tandis que les festivals de musique à eux seuls génèrent 422 kilotonnes de CO²e. Ces données montrent l’ampleur des émissions générées par le secteur de la création, ce qui justifie une analyse approfondie et des mesures concrètes pour réduire cet impact.
Une empreinte charbon généralisée
En extrapolant les données collectées, l’empreinte carbone de l’ensemble du secteur de la création artistique est estimée à 8,5 millions de tonnes de CO²e par an, représentant 1,3% des émissions totales de la France. Pour mettre ces chiffres en perspective, il est intéressant de les comparer à d’autres secteurs économiques : le transport aérien intérieur représente 0,7%, le numérique 4,4%, alors que le tourisme affiche un impact de 15% sur l’empreinte totale.
Une empreinte moyenne par catégorie
L’étude va au-delà des simples chiffres agrégés en fournissant une ventilation des émissions par catégorie d’activité. Dans le domaine du spectacle vivant, la mobilité des spectateurs représente le premier poste d’émission, à hauteur de 38%, un chiffre considérablement inférieur à ce que l’on aurait pu anticiper. Les achats de biens et services, en rapport avec les décors, costumes et accessoires, constituent également un poste significatif, à hauteur de 25%.
Pour les arts visuels, la mobilité des visiteurs domine également, atteignant 65% des émissions, tandis que les achats représentent 19% des émissions totales. Ces résultats permettent de mieux comprendre où se situe l’impact carbone et où se concentrer pour les futures actions de réduction.
Les initiatives en cours
Face à ces constats alarmants, des initiatives émergent pour promouvoir une transformation écologique au sein du secteur artistique. Par exemple, le collectif 17h25, composé de plusieurs institutions artistiques, œuvre à standardiser les châssis de décors pour éviter les transports lors des tournées, une solution qui pourrait réduire significativement les déplacements et donc l’empreinte carbone.
De même, le festival d’Avignon envisage d’utiliser le transport ferroviaire pour transporter les décors, une démarche respectueuse de l’environnement qui concerne plusieurs spectacles et représente un volume significatif de matériel à transporter.
Avenir et engagement
Les résultats de cette étude seront rendus publics en plusieurs phases, la première synthèse concernant le spectacle vivant étant déjà disponible. Les résultats relatifs aux arts visuels et l’enseignement supérieur seront présentés à la rentrée 2025. En outre, l’ensemble des conclusions fera partie de la 3e Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC), dont l’objectif est de formuler des stratégies concrètes pour réduire les émissions de GES au niveau national, tout en s’inscrivant dans l’objectif européen de neutralité carbone à l’horizon 2050.
Cette recherche s’inscrit dans le cadre d’un plan d’action plus large dédié à la transformation écologique de la création artistique, qui vise à mettre en oeuvre des pratiques durables tout en préservant la créativité et l’innovation qui sont au coeur de ce secteur.
Un cadre de politiques publiques
Les résultats de cette étude permettront également de nourrir les politiques publiques en faveur de la transformation écologique dans le secteur de l’art. Il s’agit d’une occasion d’affiner les outils et mesures déjà mis en place pour améliorer l’impact environnemental de la création. Cette démarche globale garantit que l’art, en tant que reflet de notre société, puisse également servir d’exemple en matière de responsabilité écologique.
Le chemin à parcourir
Bien que l’étude offre une première vue d’ensemble de l’impact carbone de la création artistique, il reste encore un long chemin à parcourir. Les actions visant à réduire cet impact nécessitent une implication collective et un changement de pratiques à tous les niveaux, qu’il s’agisse de la production d’un spectacle, de l’organisation d’un événement ou même de la consommation culturelle par le public.
Les formes artistiques doivent évoluer pour intégrer ces nouvelles considérations écologiques, et cela passe par une collaboration renforcée entre artistes, producteurs, autorités et consommateurs. Ces changements, bien qu’ambitieux, sont indispensables si l’on souhaite que l’art continue à prospérer dans un monde qui fait face à des enjeux environnementaux croissants.
Vers une nouvelle ère artistique
En conclusion, l’étude sur l’empreinte carbone de la création artistique représente une avancée significative dans la prise de conscience des enjeux environnementaux liés à ce secteur. Elle met en lumière non seulement l’ampleur de l’impact écologique des pratiques artistiques, mais aussi les nombreuses opportunités qui s’offrent pour transformer ce secteur en un modèle de durabilité.
En adoptant des pratiques plus durables, le monde de l’art peut jouer un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique, tout en continuant à inspirer et à ravir les audiences. Le chemin est encore long, mais les bases posées par cette recherche ouvrent des perspectives prometteuses pour un avenir où l’art et l’écologie se rejoignent harmonieusement.

Témoignages sur l’impact carbone de la création artistique
La récente étude sur l’empreinte carbone de la création artistique a suscité des réactions variées au sein du milieu artistique. Les professionnels expriment leur surprise face à l’ampleur des émissions de gaz à effet de serre générées par leurs activités. Un directeur de festival a commenté : « Il est alléchant de découvrir que notre secteur contribue à hauteur de 5% des émissions de la création artistique, mais cela doit nous inciter à agir rapidement et efficacement. »
Des artistes et des dirigeants d’institutions culturelles en appellent à un changement de cap. « Nous avons un rôle à jouer dans cette lutte contre le changement climatique« , déclare une scénographe. « Il est essentiel que nous repensons nos pratiques, de la mobilité des équipes aux matériaux utilisés pour les costumes et décors. Chaque geste compte. » Elle souligne l’importance de l’écoconception dans le processus artistique.
Les résultats de l’étude révèlent également que des discussions se nouent autour des pratiques durables. Un représentant de l’opéra déclare : « Nous devons inventer de nouvelles méthodes pour réduire notre empreinte. Par exemple, travailler davantage avec des décors modulables qui peuvent être réutilisés d’une production à l’autre serait un début concluant. » Cette idée rejoint celles de plusieurs artistes réunis en collectif pour réfléchir à des solutions concrètes.
Les professionnels de la création ne se contentent pas d’évaluer l’impact actuel. Ils sont également tournés vers l’avenir. Un chorégraphe a exprimé son optimisme : « Cette étude est une opportunité de sensibiliser encore plus notre public et d’être à la pointe de l’innovation. J’espère que cela nous poussera à agir collectivement pour réduire non seulement notre empreinte, mais aussi celle de nos spectateurs. » Cela met en lumière la nécessité d’une démarche collective pour lutter contre les effets néfastes sur l’environnement.
En fin de compte, cette étude n’est que le début. « Il sera crucial de suivre l’évolution de nos actions et de les adapter en conséquence, » prône un responsable de structure artistique. « Nous avons l’opportunité d’être les pionniers d’une véritable révolution verte dans le milieu culturel, et j’ai hâte de voir comment nous pourrons y parvenir ensemble. » Cela traduit un engagement partagé face à la responsabilité écologique qui pèse sur tous les secteurs, y compris celui de la création artistique.